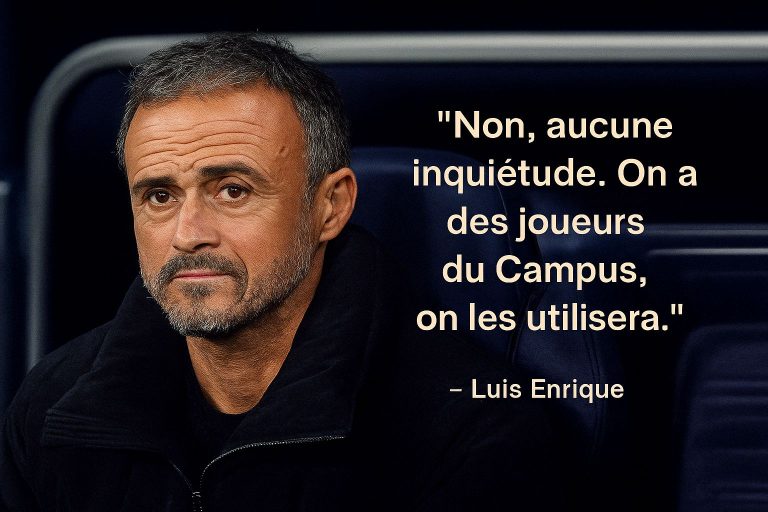En France, la préparation mentale est encore trop souvent reléguée au second plan, perçue comme un outil de secours à activer en cas de crise, plutôt qu’un levier fondamental de performance. Alors que dans d’autres pays, elle est pleinement intégrée au développement des athlètes, en France, elle reste marginalisée. Pourquoi ce retard ? Plusieurs éléments, profondément ancrés dans notre culture et notre système éducatif, peuvent l’expliquer.
Une culture de l’échec plutôt qu’une culture de la réussite
Dès le plus jeune âge, les enfants français grandissent dans un système où l’on valorise la réussite… à condition qu’elle soit parfaite. Autrement dit, l’accent est mis sur les erreurs, les fautes, les échecs, plus que sur les progrès, les efforts ou l’apprentissage. Obtenir un 18/20 n’est pas aussi bien vu que d’obtenir un 20/20. Faire une erreur, même minime, est souvent stigmatisé : une copie rendue avec des annotations en rouge, un devoir noté sans encouragements, des bulletins scolaires centrés sur les lacunes. Résultat : beaucoup d’enfants apprennent très tôt que se tromper, c’est “mal”.
Cette approche ne favorise pas le développement d’un état d’esprit de croissance, concept clé en préparation mentale. Au lieu d’encourager les jeunes à essayer, à oser, à se dépasser – quitte à échouer en chemin –, on les pousse à ne surtout pas échouer. Cette peur de l’échec devient omniprésente, limitant la prise d’initiative et développant une aversion au risque. C’est un frein majeur à la performance, notamment en sport de haut niveau où la capacité à rebondir, à gérer la pression et à apprendre de ses erreurs est essentielle.
Des institutions sportives qui perpétuent ce mode de pensée
Le monde du sport, reflet de notre société, n’échappe pas à cette logique. Nombreux sont les entraîneurs et les structures qui, consciemment ou non, nourrissent ce rapport négatif à l’échec. Il n’est pas rare d’entendre sur les terrains : « Ce joueur, dans les moments importants, il se défile », ou encore « Il n’a pas les épaules ». Ces jugements catégoriques, souvent lancés sous le coup de la frustration, figent les athlètes dans une image négative d’eux-mêmes. Ils ne sont plus des individus en progression, mais des “joueurs qui craquent sous pression”.
Cette manière de penser est non seulement contre-productive mais aussi potentiellement destructrice pour le développement personnel. En assimilant la difficulté ou l’échec à une faiblesse ou à un manque de caractère, on bloque les processus d’apprentissage, de remise en question constructive et d’adaptation émotionnelle.
Or, la préparation mentale, c’est justement cela : apprendre à gérer la pression, à rebondir après un échec, à se concentrer sur ses forces plutôt que sur ses failles. Mais tant que le discours dominant reste centré sur la peur de l’échec, les bénéfices de cette démarche resteront invisibles aux yeux de beaucoup.
Une méconnaissance du rôle du coach mental
Autre frein majeur : le manque de formation à la préparation mentale dans les cursus officiels. En France, les diplômes d’État, notamment ceux qui forment les entraîneurs, intègrent encore trop peu la dimension mentale de la performance. Résultat : beaucoup d’entraîneurs découvrent ce champ par eux-mêmes, parfois avec curiosité, parfois avec scepticisme.
Il faut être clair : tous les entraîneurs ne sont pas hostiles à la préparation mentale. Certains sont très ouverts, curieux, et collaborent volontiers avec des préparateurs mentaux. Mais une proportion non négligeable continue de penser que “la préparation mentale, c’est moi qui la gère”. Ce discours, bien que parfois animé de bonnes intentions, révèle une confusion des rôles.
Imagineriez-vous un préparateur mental décider de gérer les séances tactiques ou techniques d’une équipe ? Bien sûr que non. Ce ne serait pas son domaine de compétence. Alors pourquoi l’inverse serait-il acceptable ? La préparation mentale est une discipline à part entière, qui demande des compétences spécifiques, une formation rigoureuse, et une approche professionnelle. On ne s’improvise pas coach mental après avoir lu un article ou vu une vidéo sur la gestion du stress.
Une vision erronée de la préparation mentale
En France, la préparation mentale est encore trop souvent perçue comme une solution de dernier recours, à utiliser quand un athlète va mal, quand un joueur doute, ou quand une équipe n’y arrive plus. C’est une vision “curative”, qui oppose la préparation mentale à la “normalité”. Or, dans d’autres pays, cette discipline est intégrée de manière proactive dans l’entraînement : elle accompagne les athlètes au quotidien, les aide à se fixer des objectifs, à renforcer leur concentration, à développer la confiance en soi, à mieux communiquer…
C’est cette approche globale qui fait la différence. Des pays comme les États-Unis, l’Australie, ou encore certaines nations nordiques ont pleinement intégré la psychologie de la performance dans leur modèle sportif. Ils ne se contentent pas d’entraîner des corps : ils forment des esprits.
Un virage culturel indispensable
Pour que la France rattrape son retard en matière de préparation mentale, il ne suffit pas de proposer quelques formations ou d’inviter un intervenant en début de saison. C’est un changement profond de culture qu’il faut amorcer.
Les mentalités doivent évoluer à tous les niveaux :
- Les parents, en valorisant l’effort plutôt que le résultat ;
- Les entraîneurs, en adoptant un discours plus constructif et bienveillant ;
- Les institutions, en intégrant la dimension mentale dans les cursus de formation ;
- Les clubs, en s’entourant de professionnels qualifiés pour accompagner les athlètes.
Ce changement est déjà en marche. Les témoignages de grands champions (comme Teddy Riner, Martin Fourcade, ou encore Kylian Mbappé) qui parlent ouvertement de l’importance de la préparation mentale, participent à faire évoluer les mentalités. Les médias commencent également à s’emparer du sujet, et les jeunes générations d’athlètes sont de plus en plus conscientes de l’importance de leur équilibre psychologique.
Mais pour que cela devienne une évidence – au même titre que l’entraînement physique ou technique –, il faut que notre modèle éducatif, nos institutions sportives et notre rapport collectif à l’échec changent en profondeur.
Conclusion : jouer pour gagner plutôt que pour ne pas perdre
La préparation mentale n’est pas un luxe ou une option, c’est un pilier fondamental de la performance durable. Elle ne vise pas seulement à “réparer” un athlète en difficulté, mais à construire une base solide pour performer en confiance, en sérénité, avec du sens.
Aujourd’hui, la France accuse un retard, non pas par manque de talent ou de compétence, mais par un modèle culturel encore trop centré sur la peur de l’échec. Un modèle qui limite la liberté, la créativité et l’audace de nos sportifs.
Il est temps de changer de paradigme, de cesser de jouer pour ne pas perdre et de commencer à jouer pour gagner. Cela passe par une valorisation de l’erreur comme source d’apprentissage, par une reconnaissance du rôle des spécialistes en préparation mentale, et par une refonte de notre vision éducative de la performance.
Ce virage n’est pas seulement souhaitable. Il est indispensable pour former les champions de demain.